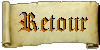|
Le site de Salon a connu une
occupation humaine ancienne mais c’est durant le haut Moyen Age,
qu’apparait la 1ère mention écrite connue de Salon. En 871,
l’existence d’une « villa Sallone », domaine agricole hérité de
l’époque Gallo-Romaine est attestée dans un acte d’inventaire de
biens, celui-ci, nous apprend que Rostans, Archevèque d'Arles,
possède des terres dans le pays Salonais. C'est à cette période
que la Provence se constitue, sous l'autorité de l'Empire
Romain Germanique. Pour des raisons diplomatiques, l'Empereur
laissa la possession des terres de Salon aux Archevèques
d'Arles, leur donnant une certaines indépendance au regard des
Comtes de Provence. Ce statut de "Terres adjacentes" de l'Empire
contribua à l'établissement de la cité puis à sa stabilité
jusqu'au rattachement de la Provence au royaume de France en
1481.

Le chateau de
l'Emperi : Pour assoir leur autorité,
les Archevèques bâtissent vers le Xème une position fortifiée
sur le rocher du Puech au coeur de la plaine de la Crau et
abrité par les Alpilles. Salon représente un carrefour
commercial stratégique entre Arles, Avignon, Aix et Marseille,
l'existence du "Castrum Salonnis" est attestée en 1144.
Aujourd'hui, le château de l'Empéri (nom de l'Empire Germanique)
représente un remarquable exemple de l'évolution de
l'architecture castrale depuis le XIIIème au XVIème. Enceinte
massive à l'origine crénélée aux nombreuses tours, donjon carré
dit "tour de Pierre Cros" au cours successives et chapelle
illustrent la première campagne de construction du XIIIème . La
cour d'honneur symbolise la recherche de confort et
d'esthétisme, animant les Archevèques qui l'occupent jusqu'à
l'orée de la Renaissance. Devenu bien national à la Révolution,
le château servit à partir du XIXe siècle de caserne. D'où la
présence imposante et anachronique du
 bâtiment
de la première cour. Fortement endommagé par le tremblement de
terre de 1909, l'édifice bénéficie dans les années 1920
d'importants travaux de restauration qui lui redonnent
progressivement sa noblesse d'origine et lui confrèrent un
nouveau rôle dans la ville. bâtiment
de la première cour. Fortement endommagé par le tremblement de
terre de 1909, l'édifice bénéficie dans les années 1920
d'importants travaux de restauration qui lui redonnent
progressivement sa noblesse d'origine et lui confrèrent un
nouveau rôle dans la ville.
Le musé de
l'Emperi : Le Château de l'Empéri
devient "Musée de l'Empéri" grâce aux frères BRUNON En 1967 le
Musée de l'Armée devient propriétaire des anciennes collections
Raoul et Jean Brunon qu'accueille alors le château de l'Empéri.
Depuis, il est devenu lieu unique où le public est invité à un
véritable voyage dans l'histoire de France, de Louis XIV à la
Grande guerre... Des soldats de Fontenoy à ceux de Verdun, tous
les aspects sont évoqués par des oeuvres uniques, tel le lit de
Napoléon à Sainte Hélène. Venir au Château-Musée de l'Empéri,
c'est aussi se laisser prendre par le charme de cette ancienne
résidence des archevêques d'Arles, devant l'élégante galerie
Renaissance, ou pour la force de l'architecture défensive
médiévale. C'est, enfin et aussi découvrir le patrimoine
salonais ou rencontrer l'oeuvre d'artistes contemporains au fil
des expositions régulièrement présentées au château.



Chapelle de
Sainte Catherine : Chapelle Romane
Sainte Catherine Du XIIème.
Tympan avec croix pattée dont les bras sont étroits au niveau du
centre et larges à la pointe. L’archevêque Gibelin de Sabran
donna la garde du château de Salon de Crau aux Templiers en
1198, ceux-ci y restèrent jusqu’en 1206. Le nom de sainte
Catherine se trouve pour la première fois dans un catalogue du
XIème, rédigé en
Grec. Vers la Même époque des ossements de femme furent
découverts par les moines du mont Sinaï, le bruit se répandit
aussitôt que l’on venait de découvrir reliques de Sainte
Catherine. Les croisés de retour dans leurs foyers, firent
connaitre en occident, l’histoire de la Sainte et construisent
de nombreuses chapelles à son nom.

L'église Saint Michel : Construite
au pied du château vers le début du XIIIème, au cœur de
l’activité de la cité, l’église Saint-Michel s’ouvre sur une
place traversée par l’un des principaux axes de communication.
Elle oriente son chevet vers l’Est, pratique particulièrement
répandue; on se tourne vers Jérusalem [et le soleil levant] pour
célébrer la messe. L’édifice illustre les spécificités de l’art
provençal par son clocher à arcades et la sobriété de ses décors
sculptés qui s’inscrivent dans le style roman, style expliquant
aussi la simplicité de son plan (nef unique sans bas-côté ni
déambulatoire), ainsi que l’épaisseur des murs et l’étroitesse
des ouvertures. L’aspect sobre et massif de l’église est éclairé
par la chaleur lumineuse de la pierre employée pour son gros
œuvre. De la même époque, le tympan sculpté qui orne son portail
évoque l’archange Saint-Michel écrasant les forces du mal
symbolisées par le serpent. Si l’aspect général de l’édifice est
typique de l’art roman, les voûtes sur croisées d’ogives de la
nef et de l’abside illustrent quant à elles l’une des premières
percées du style gothique en Provence. L’église fut donc l’objet
de plusieurs campagnes de construction successives, allant même
jusqu’à l’ajout au XVème d’un clocher couronnant la façade et
utilisé comme horloge jusqu’au XVIIème.
La Collégiale
Saint Laurent : Située "hors les murs" et bâtie par la
volonté des Salonais, la collégiale Saint-Laurent exprime le
pouvoir spirituel des archevêques d’Arles. Sa première pierre
est posée en 1344 par Jean de Cardonne en lieu et place d’une
chapelle auprès de laquelle se trouvait un cimetière. Suite à de
nombreuses interruptions des campagnes de construction (pestes,
invasion de la ville par des bandes armés, effondrements),
l’édifice est achevé près d’un siècle et demi plus tard, dans
les années 1480. De par son statut de collégiale, son imposante
silhouette se veut avant tout un signe visible de l’emprise des
archevêques sur la ville, ces derniers ayant toute autorité sur
le collège de chanoines qui président aux offices. L’art
gothique eut du mal à conquérir la Provence, Saint-Laurent s’en
inspire pourtant dans son clocher octogonal, mais surtout par le
voûtement de sa nef sur croisée d’ogives, qui permet une
élévation importante de l’édifice. Les réminiscences du style
roman sont cependant encore très présentes : peu d’évidement de
la pierre (contreforts épais, ouvertures réduites - ce dernier
constat pouvant aussi s’expliquer par la volonté de protéger
l’édifice du mistral et de la chaleur – rareté des décors
sculptés). A l’intérieur, plan et élévation sont remarquables
dans leur équilibre: nef unique, sans bas-côtés ni
déambulatoire, mais flanquée de 11 chapelles latérales. A
remarquer dans l’une d’elles (côté Nord): une majestueuse
descente de croix, sculptée et polychrome, d’inspiration
bourguignonne et datée du début du XVIe siècle. Cette oeuvre
n’était pas à l’origine destinée à la collégiale, mais fait
partie des éléments qui y furent déposés suite à la profanation,
à la Révolution, de l’église du couvent des Cordeliers de Salon.
Il en fut de même pour le Tombeau de Nostradamus, visible
aujourd’hui dans la chapelle de la Vierge. La santé du prophète
s'affaiblissait depuis longtemps, la grande climatérique était
sur lui, et le 2 juillet 1566 il finit sa carrière terrestre.
Son tombeau a été le but de nombreux pèlerinages. Parmi les
visiteurs illustres se trouvent deux rois de France, Louis XIII
(en 1622) et Louis XIV (en 1660). Ce dernier était accompagné de
sa mère, Anne d'Autriche, de son frère, le duc d'Anjou, de sa
cousine, Mlle d'Orléans, et du cardinal Mazarin. Le tombeau eut
plus tard des visiteurs moins respectueux. En 1792, les gardes
nationaux qui passaient par Salon allèrent à l'église,
profanèrent le tombeau du prophète et dispersèrent ses os. On
raconte que le soldat qui le premier viola le tombeau fut
fusillé quelques jours plus tard pour avoir volé de
l'argenterie, ainsi s'accomplit la vengeance de Nostradamus. Sur
son sépulcre fut gravée l'épitaphe suivante : « Ci reposent les
os de Michel Nostredame, duquel la plume presque divine, a été
de tous estimée digne de tracer et rapporter aux humains selon
l'influence des astres, les événements à venir par dessus tout
le rond de la terre. Il est trépassé à Salon de Craux en
Provence l'an de grâce 1566, le second juillet, âgé de
soixante-deux ans six mois dix-sept jours. O posteres, ne
touchez à ses cendres, et n'enviez point le repos d'iceluy ».
La Tour et porte
de l'Horloge : Bâtie sur l'emplacement de la porte nord
des remparts de la vieille ville, la porte de l'Horloge marque
le passage de la ville moderne à la ville ancienne. Elle est
construite au 17 siècle, coiffée d'un campanile de Roland. Un
semainier représente chaque jour de la semaine en fonction des
planètes, le Soleil pour le dimanche, la Lune est le lundi, Mars
est le mardi, Mercure est le mercredi, Jupiter est le jeudi,
Vénus est le vendredi, Saturne est le samedi. La Porte de
l'Horloge a été entièrement rénové au printemps 2003, la Tour de
l'Horloge est inscrite monument historique, le beffroi et la
cloche sont classés Monument Historique.

L'Hotel de Ville
: De style classique malgré les deux échauguettes qui
ornent sa façade, l'Hôtel de Ville fut construit de 1655 à 1658.
Son orientation prouve que la ville s'était alors libérée de la
ceinture des remparts qui l'enserrait au Moyen-Age. Sur sa
façade, deux statues symbolisent la Prudence et la Tempérance.
Sa couleur est dûe à l'emploi de la pierre de Rognes, ou de
Saint Laurent.
Le monument aux
morts d'Eugene PIRON : Le 9 août 1919, le Conseil
Municipal de Salon lance une souscription pour l'édification
d'un monument aux morts et vote une somme de 10 000 Francs à cet
effet. L'emplacement fixé est la falaise du Cimetière St-Roch,
le projet d'Eugène Piron est retenu, voici comment l'artiste
décrivait lui-même son projet: "Le monument entièrement taillé
dans le roc représente une brèche qui semble accèder au caveau
où sont déposés les morts. A l'entrée de cette brèche, un
clairon sonne le "Sublime Réveil" qui fait surgir en foule
l'image de ceux qui dorment là.." On l'aura compris , le clairon
est la version moderne de l'ange sonnant le Jugement Dernier et
la Résurrection. Le monument est solennellement inauguré le 11
novembre 1925 et est unaniment reconnu comme unique en son
genre. Il demeure unique dans sa monumentalité, son hyper
réalisme, mais avant tout son humanité. Eugène Piron mettra
malheureusement fin à ses jours trois ans plus tard, le 17
novembre 1928. Il sera inhumé au cimetière St-Roch, au pied de
l'oeuvre qui l'a immortalisé en même temps que tous les fils de
Salon morts pour la France.
La porte du Boug
Neuf et sa vierge Noire : Cette porte de l'enceinte
médiévale montre l'importance des remparts jusqu'au XVIIème.
Sous le porche de la Porte du Bourg Neuf, une niche abrite une
Vierge Noire du XIIIème. (La statue originale de la Vierge Noire
à l'enfant" se situe dans les escaliers du Hall de l'Hôtel de
Ville! ).
Le Kiosque à
Musique : Le 1er kiosque à musique fut inauguré le 19
août 1900. C'est en 1895 que le Conseil Municipal donne un avis
favorable au projet d'installation d'un nouveau kiosque à
musique, sur le même emplacement que l'ancien. C'est la
municipalité qui se chargera de faire construire ce kiosque.
Inauguration le 12 septembre 1993.

Le quartier des
Savonniers - Villa Armieux - Palais de justice : L'essor
commercial des années 1880 a fait apparaître une nouvelle
bourgeoisie dont la richesse marque la physionomie
architecturale de la ville. Les négociants font construire des
demeures ostentatoires jouxtant l'entrepôt et les bureaux. De
toutes les villas élevées au XIXème, la plus originale est le
Château Armieux, actuel
palais de justice. Ce château
médiéval fut érigé en 1905 par un riche marchand de savon en
hommage à sa femme. C’est le style néo-renaissant qui domine de
prime abord la silhouette de la Villa Armieux. Pourtant, en s’en
rapprochant, des éléments plus « modernes » assouplissent la
rigueur de l’édifice : coupole en tuiles vernissées vertes et
nombreuses sculptures florales. Aux heures d’ouverture du
Tribunal de Commerce qui s’est installé dans ses murs, il est
possible d’admirer la superbe salle de spectacle (devenue salle
d’audience) qu’Edouard Armieux fit aménager pour accueillir le
public venu assister aux récitals de son épouse cantatrice.
L’ensemble des décors s’inspire, à des degrés divers, du style
orientalisant encore en vogue dans les années 1900.
Sur l’avenue du Commandant Sibour,
l’Hôtel Couderc, aujourd’hui enserré
dans les locaux de la clinique Vignoli, offre un très bel
exemple d’architecture balnéaire, dont les différents volumes
sont soulignés par de nombreux éléments en céramique polychrome
et terre cuite. Ce style Art Nouveau, très en vogue en France à
la fin du XIXe siècle, rencontra un grand succès à Salon dans la
décoration intérieure des villas : vitraux, peintures,
carrelages, céramiques. A l’inverse, il perça tardivement et
modestement dans l’architecture.
L’Hôtel Roche,
sur le boulevard Nostradamus, est à ce titre d’autant plus
remarquable, notamment pour son bow-window en angle (partie en
avancée formant un balcon fermé). Fers de lance de l’activité
économique de la ville, ces négociants prennent aussi une part
active à sa vie sociale et culturelle.
Ainsi, la construction du
Théâtre Armand, inauguré en 1884,
est due à la volonté et au financement d’un riche commerçant du
nom d’Armand, qui y laissera d’ailleurs sa fortune. Durant cette
même période, de nombreux « cercles » se créent, dont celui des
Arts*, ouvert en 1886.
Le Cercle des
Arts et Métiers, jadis haut lieu de la classe bourgeoise
de Salon, installa son siège dans l'édifice actuel en 1886.
Aujourd'hui l'association du Cercle des Arts et Métiers est un
centre d'art et de culture où se déroulent bon nombre de
manifestations, (expositions, conférences, journée du livre,
jeux de l'esprit, etc…). Si la première guerre mondiale, puis la
crise de 1929 marquent un coup d’arrêt à ces décennies
d’euphorie, Salon conserve de cette période un patrimoine
architectural de charme, mais aussi des savoir-faire
traditionnels.
Du haut du Massif
du Talagard, aux portes Est de la cité, la plaine se
réPar la masse sombre de ses pinèdes, le Talagard lui-même met
en valeur la clarté minérale des « bories» et des « bancau »
(cabanes et murets de pierre) qui se révèlent au détour des
sentiers. C’est encore la campagne qui colore la ville et ses
marchés, sur les étals éclatants des producteurs locaux de
fruits (dont la fameuse olive « la Salonenque »), de légumes, ou
encore d’huile d’olive et de miel. vèle dans toute sa gamme
colorée. Les zones les plus claires, la Crau sèche, ont été ont
été qualifiées d’or sous la plume de Giono. A cet or répond
l’argent des feuilles d’oliviers, vert métallique que le mistral
fait vibrer. La palette s’enrichit avec le vert tendre des
prairies irriguées, ponctué par la teinte plus profonde des
haies de cyprès bordant les canaux.
|