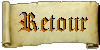|
Guillaume
Apollinaire : C'est à l'hôtel du Midi,
square de La Couronne que Guillaume Apollinaire (1880 1918) vit une histoire
d'amour avec celle qu'il surnomme Lou, Louise de Coligny-Châtillon. Cette
aventure se termine par une douloureuse rupture qui lui inspire "les
Poèmes à Lou".
Auguste
(63 av. - 14 ap. J.C.) : Premier empereur romain. Il fut divinisé et
installa les vétérans de la guerre contre Antoine à Nîmes, ce qui fit la
prospérité de la cité (cette théorie est contestée de nos jours).
Henri Bataille
: (1872-1922), poète et auteur dramatique français de la Belle Époque, qui
connut un grand succès avec des drames pathétiques et sentimentaux. Né à
Nîmes, Henri Bataille se destina d'abord à la carrière de peintre, mais
c'est comme auteur de théâtre qu'il devint célèbre. Entre l'année 1900 et la
Première Guerre mondiale (1914-1918), il fut en effet le dramaturge français
le plus en vue. Parmi ses pièces, qui font de la passion amoureuse le
principal ressort du comportement humain figurent Ton sang (1897), son
premier grand succès, Maman Colibri (1904), la Marche nuptiale (1905) et la
Femme nue (1908). Ces pièces pathétiques, alimentées souvent par les
chroniques de faits divers, paraissent pour la plupart extrêmement datées
aux yeux du lecteur moderne. Bataille est aussi l'auteur d'un recueil
poétique, la Chambre blanche (1895), d'un recueil de poèmes belliqueux la
Divine Tragédie (1917) et de la Quadrature de l'amour (1920).
Saint Baudile : Homme
d’épée vers 280 venus de Palestine, s’installe à Nîmes, alors capitale
romaine. Selon la légende, il se rend à une assemblée religieuse de
sacrifice dédiée à Jupiter ou à Mercure. En fin parleur et bon guerrier,
Baudile prend la parole, parle d’un Christ qui aurait prêché là-bas, dans
son lointain pays, s’énerve contre les barbares qui ne l’écoutent plus,
renverse les autels, blasphème. Il est décapité sur le champ par
l’assistance en furie. Ainsi le Christianisme commence dans le Gard avec le
culte du martyr. C’est un tel engouement pour lui que, vers 878, on
l’exhume et une délicieuse odeur embaume l’église, la campagne redevient
fertile et les sarrasins reculent. Un vrai miracle. Malgré la volonté nîmoise
de garder les os du saint entre ses murs, ses restes sont transférés à
l’abbaye de Saissi-les-Bois, prés d’Auxerre. Le parcours de l’attelage
est, dit on alors, jalonné de nombreux miracles et guérisons. A Nîmes, on
apprend que près de la Tour Magne, dans une combe protégée, la tête coupée
de saint Baudile a rebondi trois fois, donnant naissance à trois fontaines.
Marc Bernard :
(1900-1983) c' est
une figure atypique de la littérature française. Né à Nîmes, il quitte
l'école à 12 ans, se forme seul et el comme critique littéraire au Monde.
Il reçoit le prix Goncourt en 1942 pour "Pareil à des enfants". (
Av Feuchères)
François de Bernis
(XVIIIe) : Né à Nîmes, il devint courtisan de la cour de Louis XV, cardinal
puis ambassadeur à Rome. Son tombeau se trouve dans la cathédrale St-Castor.
Antoine Bigot : (1825-1897) est
considéré comme le plu populaire poète nÎmois. Il décrit dans ses œuvres
les petit personnages de sa ville. Son buste se trouve tout près de la statue
de Reboul dans les jardins de la Fontaine. Dans son livre “Bourgadieiro”, il
dit : “J’ai voulu noter un bruit qui s’éteint” en parlant des petites gens
et de leur langage.
Jean Bonfa :
(1638 - 1724) : Astronome nîmois.
Auguste Bosc :
(1828 - 1878) Sculpteur né à Nîmes, élève de Pradier. Il a sculpté la statue
d’Antonin, le chemin de croix de l’église St-Paul et divers autres oeuvres
locales.
Numa Boucoiran :
(1805 - 1875) Peintre nîmois ami et
disciple de Xavier Sigalon. Il a décoré plusieurs salles du palais de
justice.
Briçonnet :
(XVe - XVIe) Nom de plusieurs évêques
de Nîmes.
Cavalier :
(XIXe) Maire de Nîmes qui a entrepris
le reboisement de la colline de la Tour Magne. Il lui a laissé son nom.
René Char :
(1907 - 1988) Le poète surréaliste vauclusien vécut à Nîmes en 1927. Il
habitait la caserne et fit publier “Tombeau du secret” à Nîmes.
Antime-Denis Cohon :
Evêque de Nîmes de 1634 à 1644 et de 1655 à 1670 artisan
controversé et efficace du renouveau et de la contre offensive
catholique contre la réforme protestant.
Gaston Darboux
: (1842-1917), mathématicien français, qui a fait la synthèse des
connaissances du XIXe siècle sur la géométrie infinitésimale et a permis le
développement ultérieur de cette discipline. Né à Nîmes, Gaston Darboux
entre à l'École normale supérieure à Paris en 1861. Il y publie son premier
article sur les surfaces orthogonales, et devient professeur dans le
secondaire de 1867 à 1872. À partir de 1873, il enseigne les mathématiques à
la Sorbonne, et devient le successeur de Chasles en 1880 à la chaire de
géométrie supérieure. Il est élu membre de l'Académie des sciences en 1884,
et en devient secrétaire perpétuel en 1900. Ses travaux portent
essentiellement sur une description par l'analyse des propriétés des courbes
ou des surfaces, qu'il décrit dans les quatre tomes des Leçons sur la
théorie générale des surfaces publiés entre 1887 et 1896. Il montre dans ces
ouvrages une profonde compréhension des connections existant entre nombre de
branches des mathématiques. Dans Sur une classe remarquable de courbes
algébriques publié en 1873, il procède à une étude analytique et géométrique
des courbes, utilisant les nombres complexes pour ses démonstrations.
Alphonse Daudet : (1840-1897) Né à
Nîmes, Alphonse Daudet passe son enfance dans l’entreprise de soierie
paternelle. Il fait ses études secondaires à Lyon où la famille, ruinée,
s’est exilée. Il doit quitter le lycée à seize ans pour un emploi de maître
d’études au collège d’Alès. Il rejoint ensuite son frère à Paris pour tenter
une carrière littéraire, mais y mène une vie difficile et misérable. Il
publie un recueil de vers, les Amoureuses (1858), qui obtient un succès
mondain, place quelques chroniques dans des journaux et devient secrétaire
particulier du duc de Morny, personnage influent du second Empire. Ce poste
lui assure une aisance financière et lui laisse beaucoup de loisirs pour
écrire. Il effectue des voyages rendus nécessaires par une santé compromise.
Chantre de la Provence, auteur des Lettres de mon moulin (1869), de Tartarin
de Tarascon (1872), de la Chèvre de M. Seguin et du Petit chose. Ces succès
populaires ont en partie éclipsé son œuvre romanesque qui brosse un vaste
tableau réaliste des mœurs des années 1860-1880.
Ernest Denis :
( XIXe - XXe) Nîmois historien du peuple tchèque. Il fut plébiscité pour la
présidence de Tchécoslovaquie mais se désista. Le lycée Daudet possède
toujours une section de tchèque, Nîmes est jumelée avec Prague. La statue de
Denis se trouve Place d’Assas, côté opposé à la Maison Carrée. Un coffret
contient un peu de terre de Bohème.
Gaston Doumergue
: (1863-1937), Né à Aigues-Vives (Gard), issu d'une famille de
propriétaires terriens de confession protestante, Gaston Doumergue fut
avocat au barreau de Nîmes, élu député du Gard en 1893 puis sénateur du Gard
à partir de 1910. Cet homme d'État français, président de la République
(1924-1931) puis président du Conseil qui tenta vainement de renforcer les
prérogatives du gouvernement face aux assemblées parlementaires dans le
cadre des institutions de la IIIe République.
Retiré de la vie politique à l'issue
de son mandat en 1931, il fut rappelé à la présidence du Conseil par le
président Albert Lebrun après les émeutes du 6 février 1934, qui avaient
provoqué la démission de Daladier. Il forma alors un gouvernement d'union
nationale pour surmonter la crise politique et financière qui menaçait de se
transformer en crise de régime, et s'entoura notamment d'Édouard Herriot,
d'André Tardieu, de Louis Barthou et du maréchal Pétain. Désireux de
combattre la toute-puissance du Parlement qui paralysait toute initiative
gouvernementale, il élabora un projet conférant au gouvernement le droit de
dissoudre la Chambre des députés sans l'autorisation du Sénat, et donnant à
l'exécutif des pouvoirs plus importants en matière financière. Abandonné par
ses ministres radicaux qui l'accusaient de tentations autoritaires, il dut
présenter sa démission dès novembre 1934.
Jean Duplan :
(XIXe) Maire de la ville qui a laissé son nom à une colline nîmoise.
Vincent FaÏta : (1923-1943) fonde le
premier groupe des Francs Tireurs Partisans du sud. Un autre résistant, Jean
Robert, essaye de le libérer mais il est capturé par les Allemands. Tous
deux sont guillotinés dans la cour de la maison d'arrêt de Nîmes le 22
avril 1943.
Feuchères :
(XIXe) Pour des raisons bien précises, il
ne voulut pas de l’héritage de sa femme et en fit cadeau aux oeuvres
charitables nîmoises. La ville, en signe de reconnaissance, donna son nom à
l’avenue.
Esprit Fléchier :
(1632 - 1710) Évêque de Nîmes pendant la
guerre des Camisards. Il fut reçu à l’Académie française en même temps que
Racine (1673).
Graverol :
(XVIIe) Un des fondateurs de l’académie de
Nîmes. Il était protestant et fut persécuté pour ses convictions.
François Pierre Guillaume Guizot
: (1787-1874), homme politique et historien français. Né à Nîmes, de parents
protestants, François Guizot émigre en Suisse avec sa famille pour fuir la
Terreur sous laquelle son père a été exécuté. En 1805, il quitte Genève pour
Paris où il entreprend de brillantes études. Reconnu pour son érudition et
sa capacité de travail, il devient professeur d’histoire moderne à la
Sorbonne dès 1812. Lors de la Restauration, il rallie le parti du «
juste milieu » (favorable au libéralisme et à la monarchie
constitutionnelle), et s’oppose alors aux « ultras » désireux d’un retour à
l’Ancien Régime et dirigés par le frère de Louis XVIII (le futur Charles X).
Les convictions de Guizot le rapprochent du roi qui cherche à concilier les
intérêts de la bourgeoisie libérale et des royalistes. Laissant de côté ses
activités d’enseignant, il occupe de 1816 à 1820 le secrétariat général du
ministère de l’Enseignement, puis de la Justice, avant d’entrer au Conseil
d’État. Revenu à l’histoire après la chute du cabinet Decazes (février
1820), il retrouve pour un temps la Sorbonne. En effet, avec l’avènement de
Charles X, Guizot passe dans l’opposition et ses attaques contre le
ministère Villèle lui valent une suspension de 1822 à 1828. Il profite de
cette retraite forcée pour publier ses critiques dans le Globe, prônant la
doctrine libérale et le credo « Aide-toi, le ciel t’aidera ». En 1830,
François Guizot participe au renversement de Charles X — notamment en
signant l’« adresse des 221 » —, avant d’être élu député de Lisieux. Le
parti de la Résistance, dont il est le fondateur, est hostile à toutes les
concessions démocratiques et défend une monarchie bourgeoise garantissant
l’État contre les républicains ; c’est dans cet état d’esprit que Guizot
entre au gouvernement. Après avoir occupé l’Intérieur (1830), il obtient le
portefeuille de l’Instruction publique (1832-1837) et réorganise
l’enseignement primaire : loi de juin 1833, complétée par celle de 1841
restreignant le travail des enfants. En charge des Affaires étrangères
(1840-1847) — après une ambassade à Londres —, Guizot poursuit une politique
de rapprochement avec la Grande-Bretagne. Quoique sous l’autorité nominale
du président du Conseil Soult, il est de fait, dès 1840, le véritable chef
du gouvernement et, depuis le retrait de Thiers, l’unique chef de file de la
« Résistance ». Soutenu par la France des notables et de la bourgeoisie
d’affaire, il concourt à l’essor de l’industrie, du commerce, du crédit et
lance la révolution du chemin de fer ; son maître mot, révélateur de son
option capitaliste est sa célèbre formule, prononcée en 1843 lors d’un
banquet en province : « Enrichissez-vous par le travail, par l’épargne et la
probité ». Ayant délaissé la condition ouvrière et refusant toute
réforme électorale (sur la baisse du cens), Guizot doit affronter la
critique conjuguée des ultras et des républicains. Son gouvernement devient
de plus en plus autoritaire, et vire vers un ultra conservatisme que la
crise économique de 1846 rend difficilement supportable à l’opposition, que
ce soit celle de la petite bourgeoisie ou du prolétariat urbain. Ses élans
d’autoritarisme scellent son destin : lorsqu’au début de l’année 1848,
Guizot interdit de nouveau les réunions publiques de l’opposition, il
déclenche un mouvement révolutionnaire que sa démission ne peut enrayer et
qui aboutit à la fin du règne de Louis-Philippe (voir campagne des
Banquets). Exilé en Belgique puis en Grande-Bretagne, Guizot revient
en France en 1849. Il choisit alors de vivre à l’écart du pouvoir, se
consacrant à la rédaction de ses mémoires (Mémoires pour servir à l’histoire
de mon temps) et reprend ses recherches historiques. En 1820, il a déjà
rédigé un manifeste monarchiste et parlementariste, Du gouvernement de la
France, tout en publiant plusieurs études sur l’histoire de France et de
l’Angleterre (notamment des Essais sur l’histoire de France). Professeur de
formation et pédagogue, il rédige, à la fin de sa vie, une Histoire de
France racontée à mes petits enfants. Membre de l’Académie française à
partir de 1836, Guizot, qui n’a jamais cessé d’être homme de lettres, reste
l’un des principaux historiens du XIXe siècle et participe à la grande
tradition contemporaine des hommes politiques, tels Thiers, Blanc ou Quinet,
versés dans la science historique. L’ensemble de l’œuvre historique de
Guizot reste marqué par l’empreinte de son engagement politique, ce qui a
plus tard incité l’historien Gabriel Monod à dire de lui que, en dépit de
son pragmatisme et de ses contributions scientifiques, Guizot a été une «
personnalité » plus qu’un « savant ».
Guillemette :
(XIIe) Épouse de Bernard Aton V, vicomte de Nîmes. C’est elle qui fit prêter
serment aux chevaliers des arènes afin qu’ils restent fidèles au comte de
Toulouse en 1166.
Montcalm de Saint-Véran, Louis Joseph,
marquis de (1712-1759), général français, qui
défendit les
possessions françaises en Amérique du Nord. Né à
Nîmes, Montcalm entre dans l’armée à l’âge de neuf ans. Au cours des années
suivantes, il combat en Rhénanie, à Prague et en Italie, campagnes lors
desquelles il est blessé cinq fois. En 1756, il reçoit la charge de maréchal
de camp et la mission de diriger les troupes françaises en Amérique du Nord,
lors de la guerre de Sept Ans. Il remporte de brillantes victoires (William-Henry,
1757, Carillon, 1758). Mais les Anglais, après avoir pris la forteresse de
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), remontent le fleuve Saint-Laurent vers la
ville de Québec. Ils débarquent à l’île d’Orléans et tentent de passer sur
la rive nord, près des chutes de Montmorency où les Français, qui les
attendent, parviennent à les repousser. Maîtres du fleuve, les Anglais
bombardent la capitale pendant plusieurs jours. Mais, l’automne arrivant,
les navires, dirigés par l’amiral Saunders, doivent prendre le chemin du
retour avant d’être pris dans les glaces. Le commandant des troupes
anglaises, James Wolfe, décide alors d’effectuer un débarquement en force
dans la nuit du 12 septembre 1759. Montcalm, campé sur la côte de Beauport,
est pris par surprise. Apprenant la nouvelle du débarquement des Anglais sur
les plaines d’Abraham, il arrive avec ses troupes pour les affronter. Sans
attendre des renforts, pourtant à proximité, l’armée régulière française
fait face aux troupes anglaises. Les miliciens canadiens et les alliés
amérindiens, postés dans les zones boisées, font également feu. Cependant,
le combat tourne vite en faveur des assaillants anglais. Le commandant
anglais, James Wolfe, meurt et Montcalm, blessé mortellement, décède le
lendemain. Il est inhumé dans un cratère d’obus sous la chapelle des
Ursulines. Ce combat, appelé depuis bataille des plaines d’Abraham, permet
aux Anglais de prendre Québec et de préparer l’attaque sur Montréal, qui
tombera l’année suivante face à l’avance conjuguée des troupes britanniques
venues à partir de Québec, par la rivière Richelieu, et à l’ouest par le
fleuve Saint-Laurent.
Mathieu Lacroix :
(1819 - 1864) Poète occitan né à Nîmes. Il était
artisan maçon.
Bernard Lazare : Fils
d'un négociant tailleur Nîmois (1865-1903), ce journaliste libertaire juif
écrit un essai sur l'antisémitisme et est l'un des premiers à défendre le
capitaine Dreyfus. Près de l’entrée est du jardin de la Fontaine, une plaque a
été apposée. (rue de Bernis)
Marguerite Long : Cette Nîmoise
(1874-1966) prend ses premières leçons de piano au conservatoire de sa ville
natale, Nîmes. Concertiste, elle contribue à faire connaître l'œuvre de
Ravel. Un concours de musique classique national porte son nom. (14 Grand Rue)
Jorgi Martin Cet écrivain nîmois mort
en 1881 obtient le rang de majoral au Felibrige, l'école de Frédéric
Mistral. (6 rue Curateri)
Albin Michel : (XIXe) Archiviste
municipal de Nîmes, il a écrit un livre sur les rues de la ville.
Gaston Milhaud : (1858-1918) enseigne à
la Sorbonne. Ce Nîmois d'origine, agrégé de mathématiques, a publié des
ouvrages scientifiques et historiques. (rue St Castor)
Frédéric Mistral C'est dans un hôtel
au 22 bd Courbet qui fait le coin entre le Bureau et le Cat's hôtel que
Frédéric Mistral ( 1830-1914) loge à Nîmes quand il vient passer son bac.
Le poète provençal a défendu les traditions de sa région et a notamment
publié le premier dictionnaire Provençal Français. ( autre adresse :
2 rue Briçonnet ou il écrivit des poésies )
Léopold Morice :
(1846 - 1920) Sculpteur né à Nîmes. On lui doit les deux statues de la
façade de la galerie Jules Salles.
Charles Joseph Natoire
: (1700-1777), peintre français, l’un des maîtres du style rococo. Né
à Nîmes, Charles Joseph Natoire obtient en 1721 son premier prix de peinture
à l’École nationale des beaux-arts de Paris avec "Manué offrant un sacrifice
pour obtenir un fils". Il séjourne à Rome où il parfait son talent et entre
en 1734 à l’Académie de France à Rome où il est nommé professeur deux ans
plus tard. Peintre galant, dans le style de Boucher, il orne, entre 1737 et
1740, tous les panneaux peints du salon ovale de l’hôtel de Soubise, de
scènes retraçant la vie de Psyché. Dans ce même chantier travaillent aussi
Carle Van Loo, Restout, Boucher et Trémolière. Personnalité originale de la
tradition rococo, Natoire est un peintre et dessinateur au goût raffiné et
mesuré, particulièrement inspiré par le genre lyrique (l’Éducation de
l’Amour ; Narcisse se mirant dans la fontaine ; les Trois Grâces ; Louis,
dauphin ; la Jeunesse et la Vertu présentant deux princesses à la
France...). Entre 1735 et 1744, Natoire dessine également avec bonheur des
cartons pour des tapisseries de Beauvais qu’il réalise dans le style Louis
XV. Nommé directeur de l’Académie de France à Rome de 1751 à 1775, il y
accueille vraisemblablement Hubert Robert. Outre les décors, il signe,
notamment en Italie, de nombreux paysages.
Jean Nicot :
Jean Nicot (1530 1600, 1 place de
l'Horloge), né à Nîmes est ambassadeur de France au Portugal. c' est de ce
pays qu'il ramène 1561 un produit dont il répand l'usage en France: le
tabac. Secrétaire d’Henri II, Jean Nicot, seigneur de Villemain,
devient ambassadeur de François II à Lisbonne à partir de 1559. À son retour
du Portugal en 1561, il rapporte en France une plante, « le tabaco », que
l’on baptise de son nom, « nicotiane ». Il est l’auteur d’un des premiers
dictionnaires de la langue française le Thresor de la langue française, paru
après sa mort, en 1606.
Jean Paulhan :
(1884-1968), dont une plaque à son nom surplombe l'entrée du Prolé, règne
Sur les belles Lettres: il dirige la Nouvelle revue française avant de fonder
dans la clandestinité les Lettres françaises. Chercheur d'or né, à Nîmes,
il a aussi été planteur puis professeur à Madagascar. En 1963, il est admis
à l'Académie française. (20 rue Jean Reboul)
James Pradier :
(1794 - 1852) Sculpteur à qui l’on doit, entre autres, la fontaine de
l’Esplanade et une statue dans un mausolée du cimetière protestant.
Charles Questel :
(1797 - 1888) Architecte ayant réalisé l’église St-Paul et la fontaine
Pradier.
 Jean-Paul Rabaut : Dit Saint Etienne
(1742-1793) est le fils du pasteur Paul Rabaut. Il joue un grand rôle pour
l'adoption de l'Édit de tolérance de 1788 qui instaure la liberté de culte
pour les protestants. Il lutte pour la liberté de la presse et préside
l'Assemblée nationale en 1790. député du tiers-état de la sénéchaussée de
Nîmes et de Beaucaire aux états généraux de 1789, figure au
nombre de ces Hommes de la Liberté que le Gard compte parmi ses
citoyens. Instigateur de l'article 10 de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, il œuvre et
fait ainsi inscrire dans la loi la reconnaissance de deux droits
fondamentaux : la liberté d'opinion et la liberté religieuse.
Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Art. 10 -Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26
août 1789. Il est guillotiné en 1793 ( rue Rabaut st
Etienne) Jean-Paul Rabaut : Dit Saint Etienne
(1742-1793) est le fils du pasteur Paul Rabaut. Il joue un grand rôle pour
l'adoption de l'Édit de tolérance de 1788 qui instaure la liberté de culte
pour les protestants. Il lutte pour la liberté de la presse et préside
l'Assemblée nationale en 1790. député du tiers-état de la sénéchaussée de
Nîmes et de Beaucaire aux états généraux de 1789, figure au
nombre de ces Hommes de la Liberté que le Gard compte parmi ses
citoyens. Instigateur de l'article 10 de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, il œuvre et
fait ainsi inscrire dans la loi la reconnaissance de deux droits
fondamentaux : la liberté d'opinion et la liberté religieuse.
Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Art. 10 -Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26
août 1789. Il est guillotiné en 1793 ( rue Rabaut st
Etienne)
Paul Rabaut : il
a vécu à Nîmes au XVIIIe siècle est l'un des plus célèbres pasteurs du
Désert. A l'angle rue Jean Reboul et rue Ste. Irsule, se dressait sa maison,
le "logis de la Tête d'Or".
Louis Raoul :
(XVe) Fondateur de l’institution de l’Avocat
des pauvres.
Max Raphel :
(XIXe) Architecte né à Nîmes, il construisit
le musée des Beaux-Arts et la galerie Jules Salles.
Jean Reboul
: ( 1796-1864), boulanger poète, a
composé de nombreuses chansons satiriques et des poésies mélancoliques. Cet
ami de Lamartine, qui a sa plaque sur l'angle de la rue des Trois-Maures, a
aussi publié des poèmes en langue d'Oc. Sa statue sculptée par Auguste Bosc se
trouve sous un micocoulier au jardin de la Fontaine. (Rue Jean Reboul)
Pierre Scatisse :
(XIVe) Il était trésorier de la sénéchaussée
de Nîmes. Lors de la captivité de Jean le Bon à Londres durant la guerre de
Cent Ans et fut donc chargé de surveiller la collecte des impôts dans le
Languedoc.
Jacques
Séguier :
(1671-1687) Evêque de Nîmes, peu aimer par
ces diocésains et dépassé par le problèmes de la réunions des
protestants.
Séguier :
(1703 - 1784) C’est lui qui déchiffra
l’inscription sur le fronton de la Maison Carrée. Au n°7 de la rue qui porte
son nom, on peut voir sa maison qui fut utilisée comme lieu de séances de
l’Académie de Nîmes.
Pierre Sémard :
(1887 - 1942) Militant communiste, cheminot
membre du conseil d’administration de la SNCF lors de sa création. Il fut
fusillé par les nazis le 7 mars 1942.
Benjamin Valz :
(1787-1867) est un astronome qui a contribué à établir la carte du ciel.
Avec Son disciple Laurent, il découvre une petite planète qu'il baptise
Nemausus en Hommage à sa ville natale, Nîmes. (angle rue nationale et rue
des lombards)
|
 Jean-Paul Rabaut : Dit Saint Etienne
(1742-1793) est le fils du pasteur Paul Rabaut. Il joue un grand rôle pour
l'adoption de l'Édit de tolérance de 1788 qui instaure la liberté de culte
pour les protestants. Il lutte pour la liberté de la presse et préside
l'Assemblée nationale en 1790. député du tiers-état de la sénéchaussée de
Nîmes et de Beaucaire aux états généraux de 1789, figure au
nombre de ces Hommes de la Liberté que le Gard compte parmi ses
citoyens. Instigateur de l'article 10 de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, il œuvre et
fait ainsi inscrire dans la loi la reconnaissance de deux droits
fondamentaux : la liberté d'opinion et la liberté religieuse.
Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Art. 10 -Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26
août 1789. Il est guillotiné en 1793 ( rue Rabaut st
Etienne)
Jean-Paul Rabaut : Dit Saint Etienne
(1742-1793) est le fils du pasteur Paul Rabaut. Il joue un grand rôle pour
l'adoption de l'Édit de tolérance de 1788 qui instaure la liberté de culte
pour les protestants. Il lutte pour la liberté de la presse et préside
l'Assemblée nationale en 1790. député du tiers-état de la sénéchaussée de
Nîmes et de Beaucaire aux états généraux de 1789, figure au
nombre de ces Hommes de la Liberté que le Gard compte parmi ses
citoyens. Instigateur de l'article 10 de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, il œuvre et
fait ainsi inscrire dans la loi la reconnaissance de deux droits
fondamentaux : la liberté d'opinion et la liberté religieuse.
Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Art. 10 -Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26
août 1789. Il est guillotiné en 1793 ( rue Rabaut st
Etienne)