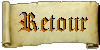|
ABBAYE bénédictine du 10ème au 18ème siècles, en direction de ARLES
(à 4 Km d'Arles). Du latin «major» (plus grand), l’île de
Montmajour, entourée d’étan gs et de marais, culmine à une
quarantaine de mètres. C’est sur ce site, aux portes d’Arles,
que s’établit une première communauté de Bénédictins en 949,
inaugurant huit siècles de vie monastique. Progressivement
agrandie et enrichi, l’ensemble monastique deviendra rapidement
un des pèlerinages les plus fréquentés en Europe, notamment lors
du Grand Pardon de la Sainte-Croix, institué en 1030. Les
nombreux édifices du site (bâtiments conventuels, cloître,
chapelles, tour) présentent un intérêt architectural de tout
premier ordre. Un nouveau monastère, édifié au XVIIIe siècle,
marque le site d’une toute autre empreinte, inspirée de
l’architecture civile grandiose et fonctionnelle. Après bien des
vicissitudes historiques, l’abbaye de Montmajour fait
aujourd’hui l’objet de nombreux travaux de restauration, la
livrant progressivement à la curiosité des visiteurs. Elle est
devenue par ailleurs un lieu d’exposition prestigieux, notamment
dans le cadre des Rencontres Internationales de la Photographie. gs et de marais, culmine à une
quarantaine de mètres. C’est sur ce site, aux portes d’Arles,
que s’établit une première communauté de Bénédictins en 949,
inaugurant huit siècles de vie monastique. Progressivement
agrandie et enrichi, l’ensemble monastique deviendra rapidement
un des pèlerinages les plus fréquentés en Europe, notamment lors
du Grand Pardon de la Sainte-Croix, institué en 1030. Les
nombreux édifices du site (bâtiments conventuels, cloître,
chapelles, tour) présentent un intérêt architectural de tout
premier ordre. Un nouveau monastère, édifié au XVIIIe siècle,
marque le site d’une toute autre empreinte, inspirée de
l’architecture civile grandiose et fonctionnelle. Après bien des
vicissitudes historiques, l’abbaye de Montmajour fait
aujourd’hui l’objet de nombreux travaux de restauration, la
livrant progressivement à la curiosité des visiteurs. Elle est
devenue par ailleurs un lieu d’exposition prestigieux, notamment
dans le cadre des Rencontres Internationales de la Photographie.
L’abbaye de Montmajour présente deux
ensembles monastiques :
1) La construction du premier s’étend
du X° au XV° siècle et commence par l’ermitage Saint-Pierre
(10ème-11ème ) constitué de deux chapelles dont l’une est
troglodyte (la crypte Sainte-Croix 11ème-12ème et la
chapelle Sainte-Croix 11ème ou 12ème). Le XIIe siècle est celui
de la première abbatiale, qui, bien qu’inachevée, s’impose par
sa grandeur, sa simplicité et sa beauté (sa voûte d’ogive date
du XIIIe s). Elle comprend des bâtiments conventuels, l’église
Notre-Dame, construite sur une crypte en partie souterraine et
ajoutée d’un cloître de style roman très décoré (tombeaux des
premiers comtes de Provence 12ème-14ème). A l’est, hors
monastère, est édifiée la chapelle Sainte-Croix, évoquant un
reliquaire monumental. Au XIVe siècle, un clocher et une
puissante tour de défense dominent l’ensemble claustral. Ses 26
mètres de hauteur, offre un large panorama qui permet de mieux
appréhender le site naturel d’origine, ainsi que la diversité
complexe des bâtiments. La construction du premier s’étend
du X° au XV° siècle et commence par l’ermitage Saint-Pierre
(10ème-11ème ) constitué de deux chapelles dont l’une est
troglodyte (la crypte Sainte-Croix 11ème-12ème et la
chapelle Sainte-Croix 11ème ou 12ème). Le XIIe siècle est celui
de la première abbatiale, qui, bien qu’inachevée, s’impose par
sa grandeur, sa simplicité et sa beauté (sa voûte d’ogive date
du XIIIe s). Elle comprend des bâtiments conventuels, l’église
Notre-Dame, construite sur une crypte en partie souterraine et
ajoutée d’un cloître de style roman très décoré (tombeaux des
premiers comtes de Provence 12ème-14ème). A l’est, hors
monastère, est édifiée la chapelle Sainte-Croix, évoquant un
reliquaire monumental. Au XIVe siècle, un clocher et une
puissante tour de défense dominent l’ensemble claustral. Ses 26
mètres de hauteur, offre un large panorama qui permet de mieux
appréhender le site naturel d’origine, ainsi que la diversité
complexe des bâtiments.
2) Le monastère Saint-Maur,
œuvre de l’architecte avignonnais Pierre Mignard, fut édifié au
XVIII° siècle pour la Communauté Réformée (Protestants). Des
vingt-huit fenêtres que comptait sa vaste façade sud, seules
quatre subsistent aujourd’hui.
Historique
: C’est à une famille
originaire de Bourgogne, les Teucinde, que les Bénédictins
doivent leur implantation en 949 sur l’île de Montmajour,
ancienne nécropole chrétienne habitée de quelques ermites.
Organisé en communauté monastique régulière, d’abord sous le
patronage de Saint-Pierre, ceux-ci vont au XIIe siècle
entreprendre un vaste chantier qui donnera naissance au premier
ensemble conventuel, placé sous la règle de saint Benoît.
Communauté prospère, lieu de pèl erinage très fréquenté, l’abbaye
de Montmajour connaîtra plusieurs siècles d’expansion et de
rayonnement. Cependant, à partir du XIVe siècle, l’établissement
est placé sous le régime de la commende (concession d’un
bénéfice à un ecclésiastique séculier ou à un laïc) ce qui
entraînera sa décadence spirituelle et matérielle. A la demande
de l’archevêque d’Arles, et contre l’avis des moines, la
congrégation de Saint-Maur est chargée de restaurer l’abbaye.
Elle en pend possession en 1639, rétablit la discipline et
engage à partir de 1703 l’édification du monastère Saint-Maur.
En 1786 l’abbaye est sécularisée puis, à la Révolution, vendue
comme bien national. Les bâtiments, en partie détruits, sont
rachetés par la ville d’Arles en 1838, classé Monument
historique à partir de 1845. Ils sont restaurés par Henri Revoil,
sous le second Empire. Depuis 1945, l’abbaye est propriété de
l’Etat. erinage très fréquenté, l’abbaye
de Montmajour connaîtra plusieurs siècles d’expansion et de
rayonnement. Cependant, à partir du XIVe siècle, l’établissement
est placé sous le régime de la commende (concession d’un
bénéfice à un ecclésiastique séculier ou à un laïc) ce qui
entraînera sa décadence spirituelle et matérielle. A la demande
de l’archevêque d’Arles, et contre l’avis des moines, la
congrégation de Saint-Maur est chargée de restaurer l’abbaye.
Elle en pend possession en 1639, rétablit la discipline et
engage à partir de 1703 l’édification du monastère Saint-Maur.
En 1786 l’abbaye est sécularisée puis, à la Révolution, vendue
comme bien national. Les bâtiments, en partie détruits, sont
rachetés par la ville d’Arles en 1838, classé Monument
historique à partir de 1845. Ils sont restaurés par Henri Revoil,
sous le second Empire. Depuis 1945, l’abbaye est propriété de
l’Etat.
La restauration, commencé par
Revoil en 1862 sur le cloître, continuera avec Formigé de 1907 à
1955. Le monastère mauriste sera consolidé à partir de 1921.
Cependant l’occupation des bâtiments par les troupes allemandes
laissera les bâtiments en piteux état. Une importante campagne
de restauration sera menée entre 1978 et 1988. Portant
principalement sur les deux monastères, les opérations ont visé
à protéger, sécuriser, voire restaurer l’existant, dans la
perspective d’un accueil du public et d’expositions. En 1999, un
nouvel espace d’accueil est conçu par l’architecte Rudy
Ricciotti. |